Article modifié le 15 février 2025
Dans une quête vers la décolonisation et la «dé-patriarcalisation» littéraire de mon esprit, j’ai établi des listes et cherché des références d’œuvres à lire ou à découvrir durant l’été 2018. C’est ainsi que le nom de Maryse Condé est réapparu dans mon espace culturel personnel.
Dans sa bibliographie, Moi, Tituba sorcière… semblait une bonne porte d’entrée. En effet, l’horizon d’attente paraît transparent : le portrait d’une femme noire dans l’un des contextes les plus violents de l’Histoire des peuples noirs, une exploration des spiritualités afro-caribéennes et une démonstration de la charge langagière que porte le substantif « sorcière ». Assez intriguant pour me donner envie d’y plonger.

Maryse Condé, une figure à la marge
Écrivaine guadeloupéenne née en 1937 à Pointe-à-Pitre dans un milieu aisé (sa mère est l’une des premières institutrices noires de la Guadeloupe et son père, le co-fondateur d’une banque locale), Maryse Condé appartient à une famille qui revendiquait appartenir au groupe des « Grands Nègres », c’est-à-dire ceux qui maitrisent les codes de la culture française blanche.
Mes parents étaient-ils des aliénés ? Sûr et certain, ils n’éprouvaient aucun orgueil de leur héritage africain. Ils l’ignoraient. C’est un fait ! Au cours de ces séjours en France, mon père ne prit jamais le chemin de la rue des Écoles où la revue Présence africaine sortait du cerveau d’Alioune Diop. Comme ma mère, il était convaincu que seule la culture occidentale vaut la peine d’exister et il se montrait reconnaissant envers la France qui leur avait permis de l’obtenir. En même temps, ni l’un ni l’autre n’éprouvaient le moindre sentiment d’infériorité à cause de leur couleur. Ils se croyaient les plus brillants, les plus intelligents, la preuve par neuf de l’avancement de leur Race de Grands-Nègres.
Maryse Condé in Le Coeur à rire et à pleurer, citée dans «Maryse Condé et les pères fondateurs de la Caraïbe francophone» de Ching Selao
C’est en arrivant à Paris à l’âge de 16 ans pour poursuivre sa scolarité, d’abord au lycée Fénelon, dont elle sera renvoyée pour insubordination et impertinence, puis à la Sorbonne, qu’elle prend « conscience d’être noire ». Le racisme aiguë dont elle est victime dans la capitale française lui apprendra « à se valoriser comme différente » déclare-t-elle dans le documentaire de Jérôme Sesquin, Maryse Condé : une voix singulière.
C’est également à Paris, qu’elle découvre Césaire et Fanon. Elle comprend, grâce à la « négritude », la singularité de l’identité noire. C’est le point de départ d’un quête des origines qui la conduira en Afrique. Plus tard, l’analyse fanonienne de l’aliénation dans Peau noire, masques blancs participera à la revendication d’une identité et d’une écriture individuelle et singulière, une écriture « en Maryse Condé ».
Son retour aux origines débute lorsqu’elle épouse le comédien guinéen Mamadou Condé. Le mariage et le voyage en Guinée sont un échec, les deux étant bâtis sur une mythification de l’Afrique et des idéaux africains. La réalité africaine est un choc auquel les théories parisiennes n’avaient pas préparé Maryse Condé. Les « bavardages politiques » des dirigeants africains tels que Sékou Touré, l’écart entre leurs paroles et leurs actes, déconstruisent son rêve africain.
Elle ne gardera de ce pays qu’une image de souffrances et de l’Afrique, elle ne retiendra que son rejet par les Africains. Dans son premier roman, d’inspiration autobiographique, Hérémakhonon (1976), l’autrice expose les dysfonctionnements des sociétés africaines à travers la mise en scène de la corruption, de la dictature et de la prison, à une époque où il était tacitement interdit de critiquer les nations africaines nouvellement indépendantes dans les milieux noirs et de gauche. L’œuvre sera très mal reçue.
En 1969, au Sénégal, elle rencontre son second mari, Richard Philcox (qui deviendra le traducteur de ses œuvres) dans le lycée où ils enseignent tous les deux. Dans le documentaire évoqué plus haut, l’écrivaine souligne la contradiction entre ses idéaux, son militantisme pour un nationalisme africain et son amour puis son mariage avec un Anglais blanc… Après douze années passées en Afrique, elle revient en France pour enseigner la littérature francophone à Jussieu, à Nanterre et à la Sorbonne Nouvelle.
Dans les années 80, elle s’installe aux Etats-Unis où elle enseignera pendant deux décennies dans les plus grandes universités. Elle est, par exemple, recrutée par l’université de Columbia en 1995 pour créer le Centre d’Études Francophones et s’enorgueillit d’avoir fait « entrer la littérature francophone dans le cursus universitaire ; [d’avoir] montré qu’elle est riche, belle, plurielle, qu’il faut absolument la connaitre, l’aimer ». Maryse Condé se souvient avec bonheur des ces années d’enseignement car, d’après elle, contrairement aux Français ayant une vision étriquée, essentiellement touristique des Antilles et se vantant de les connaître parce qu’ils y ont « dansé et mangé du boudin » (tantine Maryse n’a pas le temps), les Américains n’ont pas d’idées préconçues sur ces territoires, leurs discours et leur regard sont différents.
Ce franc-parler dont elle fait preuve et la singularité qu’elle revendique au sein des lettres antillaises et francophones ont contribué à une méconnaissance locale de son œuvre. Elle confie à J. Sesquin, en 2011, avoir quitté sa terre natale à cause du mépris envers son travail. Pourtant en 2018, en recevant le Nouveau Prix de Littérature de la Nouvelle Académie (plus connu sous le nom de Nobel alternatif de littérature) elle le dédie aussi à la Guadeloupe, marquant ainsi son attachement et sa relation complexe à cette île. Maryse Condé regrette plus largement l’ignorance de la France face au travail effectué par les auteurs africains et antillais de langue française. Dans une conversation avec le réalisateur haïtien Raoul Peck, elle dénonce l’ingratitude de la France envers celles et ceux qui diffusent une image différente de ce pays et s’échinent à faire vivre la langue française.
L’un des grands regrets de la romancière est l’échec face au Prix Nobel (officiel) de littérature. Elle considère cet échec comme une dévalorisation de son talent et de son travail. Dans une émission consacrée à l’autrice sur France Culture, Françoise Pfaff, universitaire et amie de Maryse Condé, affirme que ce prix lui échappe à cause des thèmes qu’elle traite « qui ne sont pas tendres avec l’Europe », ce que confirme Christiane Makward dans la même émission : « Maryse Condé paie le prix de sa verdeur de parole ».
Si l’écrivaine guadeloupéenne rejette l’étiquette de la littérature engagée, elle n’hésite cependant pas à prendre position face aux débats politiques ou sociaux. Elle a milité pour l’indépendance de la Guadeloupe et est devenue, en 2004, la première présidente du Comité Nationale pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage, une façon, pour elle, de « réparer le silence et la passivité de ses parents et [d’être] plus ouvertement utile qu’en écrivant ». Elle déclare, dans le documentaire de Jérôme Sesquin, que le rôle « d’une femme noire, écrivain, est de transmettre aux autres, un respect, un amour de la différence, c’est la beauté de [son] travail et de [son] origine ». Elle cite d’ailleurs, dans ce sens, la phrase du militant jamaïcain (et prophète rastafari) Marcus Garvey « I shall teach the black man to see the Beauty in himself ».
Tituba, une personnage historique trouble
Moi, Tituba sorcière… met en scène un personnage historique qui s’est retrouvé, entre 1692 et 1693, au centre du procès des sorcières de Salem grâce à son témoignage. Ses contours ont été rendu confus par l’absence de documents quant à son existence avant et après ces évènements mais surtout à cause du regard raciste des auteurs et des historiens américains.
On retrouve aujourd’hui quelques références à ce personnage dans la culture populaire surfant sur une nouvelle vague féministe qui tente de réhabiliter la figure de la sorcière (et parce que the devil works hard but capitalism works harder, dans la marchandisation qui l’accompagne, à base de cristaux, tarots, tee-shirts et petites culottes ou autres accessoires considérés comme appartenant aux sciences occultes). Ainsi, la sorcière interprétée par Gabourey Sidibe dans la série American Horror Story: Coven est une descendante de Tituba ; dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina, Tituba est invoquée lors d’un rituel d’exorcisme et enfin, elle apparaît également dans la série fantastique Salem.


Au commencement… Tituba était une Indienne caraïbe. L’universitaire Elaine Breslaw pense même qu’elle serait d’origine sud-américaine (mais on lui reproche de ne pas apporter les preuves démontrant cette hypothèse). Quoiqu’il en soit, l’origine tout comme la pratique occulte de Tituba ont été modifiées au fil des siècles et des écrits. Sorcellerie d’inspiration anglaise puis indienne (native) et enfin africaine est mise en parallèle avec une Tituba indienne, puis à moitié indienne puis à moitié noire et enfin simplement noire. Les Sorcières de Salem d’Arthur Miller ancre dans l’imaginaire collectif la représentation d’une Noire pratiquant le voodoo. Dans son article « The Metamorphosis of Tituba, or Why American Intellectuals Can’t Tell an Indian Witch from a Negro » publié en mars 1974, Chadwick Hansen analyse le processus qui a conduit à cette confusion.
Dans les récits et les documents contemporains au procès de Salem, Tituba est une esclave indienne appartenant à Samuel Parris chez qui on place le foyer des phénomènes occultes car sa fille et sa nièce sont les premières à montrer des convulsions, épisode que reprend Maryse Condé. La jeune femme serait venue de la Barbade avec le pasteur en 1680. On la pensait mariée à un autre esclave de Parris, John Indien.
À l’origine des phénomènes se manifestant à Salem, se trouvent deux jeunes filles tentant de lire l’avenir (et de découvrir ainsi le futur de leurs prétendants). La tradition veut que Tituba ait été présente lors de ces cérémonies. En 1692, on trouve des traces écrites des crises décrites dans le roman de Maryse Condé et dont sont victimes les jeunes gens évoqués ci-dessus. Mais, si des soupçons de sorcellerie circulaient déjà dans le Massachusetts, Tituba ne semble pas faire partie des complices ou des accusées de cette première vague. À la même époque, les pratiques dénoncées sont de tradition anglaise comme le Witch’s cake, gâteau à base de farine de seigle et d’urine dont Mary Sibley conseille la préparation à Tituba dans la fiction de l’écrivaine guadeloupéenne. Ce « gâteau de sorcière » devait confondre les personnes possédées par le Malin.

Au XIXᵉ siècle, H.W. Longfellow, dramaturge américain, cité par Chadwick Hensen, propose dans sa pièce Giles Corey of the Salem farms (1868) le portrait d’une Tituba de mère indienne (native) et de père Obi, « a man all black and fierce… He was an Obi man and taught her magic ». La religion Obi (ou Obeah) est un culte syncrétique créé dans les Antilles par les esclaves originaires d’Afrique de l’Ouest. Cette référence met donc en exergue l’origine africaine de Tituba et de sa magie. Cette image perdurera jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Dans les années 50, ce métissage prédomine mais les écrivains et les historiens, s’appuyant sur les sources littéraires, insistent sur des caractéristiques (racistes) alors rattachées aux Noirs tels que la paresse dont Tituba ferait preuve et son anglais maladroit. Peu à peu, ses traits caraïbes disparaissent ou sont occultés. Dans une pièce intitulée Tituba’s Children de William Carlos Williams (1965), cité par Chadwick Hensen, on la nomme par sa couleur de peau et sa condition : « a black slave » ou « that black Woman ».
Dans Les Sorcières de Salem (1953), Arthur Miller rattache définitivement Tituba à la condition noire en la nommant « a negro slave ». Sa pratique de la magie devient aussi plus noire : elle est à présent un prêtresse vaudou. Mais surtout l’image que propose Miller s’inscrit dans la tradition des représentations stéréotypées et humiliantes des personnages noirs dans la culture blanche américaine, celle des minstrel shows et de leur blackfaces. Dans la tragédie de Miller, Tituba est une « esclave de maison » soumise et souriante qui protège les intérêts de ses maîtres blancs. Le personnage de Mammy dans Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell et son interprétation dans l’adaptation cinématographique de Victor Flemming est un prototype de cette figure de Noire vue par les Blancs.
C. Hensen prouve donc que ce personnage historique évolue avec les préjugés raciaux construits entre la Guerre de Sécession et la Première Guerre Mondiale par la société américaine blanche. Ces préjugés s’amplifient dans les années 70 et sont confortés par des stéréotypes racistes face aux superstitions. L’universitaire souligne l’impossibilité pour les écrivains et les historiens blancs américains de montrer voire d’imaginer une sorcière anglaise, de la Nouvelle-Angleterre, comme personnage à l’origine des « phénomènes de sorcellerie » observés dans cette région. L’ethnocentrisme renforcé par leurs préjugés sur les personnes noires et les manquements aux devoirs de documentation et de confrontation des historiens ont contribué à créer la figure mythique de Tituba.
Si son témoignage permet de découvrir quelques éléments de sa vie, il permet surtout de comprendre la place qu’elle a prise, malgré elle, dans cette « chasse aux sorcières ». En effet, les paroles de la vraie Tituba est le point de départ de nombreuses condamnations. À l’automne 1692, on dénonce entre 144 et 185 sorcières et sorciers et on pend 19 hommes et femmes. Son récit, à l’invitation de ses juges, donne vie aux craintes des Puritains de la Nouvelle-Angleterre. Elle construit un imaginaire du monde occulte en utilisant les peurs et les obsessions des habitants de Salem et du Massachusetts. Elle sera, par exemple, la première à évoquer des sorcières volant, la nuit, à Salem.
Ce témoignage est aussi l’un des plus longs du procès et révèle, d’après Stacy Schiff du Smithsonian Magazine, les talents de conteuse de Tituba, prête à s’adapter aux attentes de son auditoire. Malgré cela, elle attendra quinze mois en prison avant son procès, le 9 mai 1693. Le jury ne se prononce pas sur sa culpabilité et elle quitte le Massachusetts puis on ne trouve plus aucune trace d’elle. C’est dans les silences et les inconnus de son parcours, dans les failles de l’historiographie que Maryse Condé va s’introduire pour raconter la vie de Tituba : qui est-elle ? d’où vient-elle ? que pense-t-elle de cette espèce d’apocalypse qui bouleverse son quotidien ? que devient-elle après avoir offert aux Puritains de Salem ce qu’ils souhaitaient entendre ?
Tituba racontée par Maryse Condé
Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem n’est pas le titre que Maryse Condé souhaitait donner à son roman. Citée par Julie Brugier dans son article « Ebranler la marge dans Moi, Tituba sorcière… noire de Salem (1986) et Memorial de Maria Moura (1992) de Rachel de Queiroz », l’écrivaine explique que sa première proposition était une formule plus simple : Moi, Tituba. Dans la postface de l’édition américaine, elle précise cependant « but the publishers said that was a bit laconic as a title and added Black Witch of Salem. » Ainsi, l’emphase que l’autrice avait marqué par l’utilisation du pronom tonique ne suffisait pas à identifier ce récit de vie, les éditeurs ont souhaité mettre l’accent sur la marginalité et l’exotisme du personnage afin d’inscrire l’œuvre dans la mouvance de la littérature post-coloniale.
Julie Brugier affirme que c’était également un moyen d’exploiter l’ethnicité de Maryse Condé comme l’illustre les choix de l’édition folio. L’idée de la réhabilitation, à travers le roman, d’une figure marginale est explicitement annoncée sur la quatrième de couverture : « Maryse Condé la réhabilite, l’arrache à cet oubli auquel elle avait été condamnée […] ». Le tableau de Marie-Guillemine Benoist choisi pour illustrer la couverture complète ce projet commercial : le portrait d’une belle jeune femme anonyme (des recherches récentes ont retrouvé l’identité de Madeleine qui était une domestique du beau-frère de l’artiste), ancienne esclave, originaire de Guadeloupe, permet la double référence à Tituba et à Maryse Condé. La réception critique s’inscrivant dans ce projet éditorial n’est donc pas surprenante. Tituba devient « la quintessence du portrait du sujet marginalisé : elle est esclave, femme, victime de l’économie coloniale et en apparence oubliée par les archives historiques » écrit l’universitaire Dawn Fulton citée et traduite par Julie Brugier. Et c’est qui qui tombe dans le panneau du marketing ? C’est Bibi !

source : https://www.histoire-image.org/fr/etudes/portrait-negresse
Beaucoup de choses à dire à propos de ce tableau mais surtout de sa réception… mais ce n’est pas le sujet du jour.
Cette lecture de Tituba en tant que figure marginale réhabilitée ne serait pas forcément artificielle. En effet, en « vieille marxiste » comme elle se définit, Maryse Condé a conscience que deux mondes s’opposent « celui des opprimés et celui des oppresseurs » et c’est cela qu’elle veut dépasser en donnant voix à un personnage opprimé. Le roman est construit comme un récit autobiographique, fruit d’une conversation entre Tituba et Maryse Condé, comme un passage de l’échange oral à la trace écrite comme nous invite à penser la première épigraphe ouvrant le récit « Tituba et moi, avons vécu en étroite intimité pendant un an. C’est au cours de nos interminables conversations qu’elle m’a dit ces choses qu’elle n’avait confiées à personne ». Pourtant, cette épigraphe peut tout aussi bien être lue comme une métaphore ou comme une parodie des romans historiques ou biographiques du XVIIIᵉ siècle ou encore comme la volonté de l’autrice de marquer son autorité sur le texte, d’autant plus que sa voix encadre le récit à la première personne de Tituba (cf. les épigraphes et la note historique)… Et c’est là toute l’ambiguïté de l’écriture de Maryse Condé.
La critique a donc insisté sur la dimension historique et réhabilitatrice du roman, influencée par les choix des éditeurs mais également par la lecture d’Angela Davis autrice de la préface de l’édition américain qui déclare : « Maryse Condé lends [Tituba] the words that assist her to tell you and me her story, speaking her life in her own voice ». L’universitaire Elisabeth Mudimbé-Boyi, dans son article « Giving a Voice to Tituba: The Death of the Author? » paru dans le numéro 67 de la revue World Littérature Today, confirme cette lecture : « In transcribing Tituba’s voice, Condé, as the writer, has not only joined her in challenging Christopher’s assertion about the worthlessness of a « common Negress » but has also empowered her and create a territory for her in history and literature, allowing her to survive as a black female literary character, if not a historical figure ». On peut donc aisément succomber à la tentation de cette lecture post-coloniale d’autant plus que les paroles de Tituba elle-même invite à lire le roman comme une réponse à ses inquiétudes : « Je sentais que dans ces procès des sorcières de Salem qui feraient couler tant d’encre, qui exciteraient la curiosité et la pitié des générations futures […] mon nom ne figurerait que comme celui d’une comparse dans intérêt. […] On ne se soucierait ni de mon âge ni de ma personnalité. On m’ignorerait. » (p.173, folio). Le roman peut donc être envisagé comme une manière pour Maryse Condé de conjurer la prophétie de son personnage.
C’est sans doute pourquoi les éléments historiques prennent une place importante dans le récit. Pour la femme de lettres, la fiction historique est un moyen de révéler la vérité historique, un détour nécessaire, « plus confortable », pour transmettre la réalité lorsqu’elle est violente, comme celle de l’esclavage. Elle ajoute même que si elle n’avait pas été écrivaine, elle serait devenue historienne et son premier succès Segou (1984-1985) marque l’importance de l’Histoire dans son écriture. Si elle ne revendique pas pour Tituba le caractère de figure historique, Maryse Condé forge tout de même une contre-histoire des procès de Salem en dirigeant notre regard sur cette « sorcière noire » qui n’était jusqu’alors qu’un nom dans les archives. Le fait qu’elle verbalise les inquiétudes du personnage concernant son héritage historique et la trace mémorielle qu’elle laissera confirme cette réécriture voire cette réappropriation de l’historiographie écrite par le groupe dominant. La note historique complétant l’édition française confirme ce projet tout en établissant la distance fictive choisie et assumée par l’autrice. En parlant du destin de Tituba, elle écrit : « Le racisme, conscient ou inconscient, des historiens est tel qu’aucun ne s’en soucie. […] Je lui ai offert, quant à moi, une fin de mon choix. » Auntie is trying too hard to play us… mais la contradiction est son sport favori d’après ses propres mots dans Maryse Condé : une voix singulière, le documentaire de Jérôme Sesquin.
Elle fait voir et raconte.
Christiane Makward à propos de Maryse Condé dans l’émission La Compagnie des auteurs, France Culture, 22/02/2018
Le talent de narration de Maryse Condé est aussi enchanteur que celui de Tituba : on est plongé dans le récit sans pouvoir se détacher des aventures du personnage principal. Le monde extérieur n’existe plus, malgré le manque d’hygiène de certains dans les transports en commun (parce que c’est devenu le seul endroit où j’ai à peu près le temps de lire #VDM), et l’univers du roman nous happe jusqu’au point de nous faire ressentir la douleur, la gêne et le malaise de manière saisissante. Le choix du cadre spatio-temporel s’inscrit dans ce projet : la Barbade et la Nouvelle Angleterre durant la deuxième moitié et la fin du XVIIᵉ siècle, c’est-à-dire à l’apogée de la traite transatlantique et d’une idéologie chrétienne blanche qui en était devenue la garante morale (et financière).
Ce cadre permet à l’écrivaine d’aborder la violence et la virulence des discriminations à l’intersection de la race et du genre aux Etats-Unis. À l’espace insulaire, la Barbade, où un semblant de liberté et de bonheur est envisageable malgré l’oppression, s’oppose le territoire morne du Massachusetts, où même l’espoir est définitivement interdit. Le cadre empli de violence est celui des Blancs et du christianisme : c’est ainsi que dès l’incipit, le roman nous plonge sans ménagement dans la barbarie de la traite et dans les souffrances que vivra Tituba à travers le viol de sa mère sur un navire anglais, le « Christ King ». Le récit à la première personne participe également à cette impression d’immédiateté et d’intimité : au fil des pages, on prend en plein visage les émotions et les sensations des personnages. Maryse Condé dans son projet d’éveiller nos consciences à l’hypocrisie puritaine blanche et à l’oppression des personnes noires n’épargne aucun détail. Cependant « l’érotisme, l’horreur, la haine, le crime n’est pas [le] fond de commerce [de Maryse Condé] » comme le rappelle Christiane Makward. Il faudrait donc lire le roman, dans ses excès, comme une parodie épique…
Les éléments de la parodie se lisent aisément dans certaines scènes érotiques comme la première nuit de Tituba et John Indien, digne d’une romance à l’eau de rose un peu pimentée, ou dans la description de ses relations sexuelles avec Benjamin Cohen d’Azevedo, que la narratrice elle-même ne prend pas au sérieux. Cette sexualité qui peut paraître exacerbée provoque, d’abord, un certain malaise mais permet, aussi, de renforcer l’écart entre Tituba et les Puritains de Salem pour qui le corps est source de honte et de dégoût. Son interrogation sur l’éventuel plaisir qu’aurait ressenti Abena, sa mère, lors du viol, est insultante pour toute personne dotée d’un sens moral mais pour Maryse Condé, c’est une provocation permettant d’indiquer qu’on entre dans « un roman, dans lequel l’innommable est nommé » selon Ching Selao et elle ajoute en citant Kathleen Gyssels que c’est également une réaction au « complexe de victime qui, il est vrai, n’en finit pas de colorier les récits de témoignage antillais, surtout féminins ». La romancière joue ainsi de la candeur de sa narratrice pour initier son lectorat à la réflexion et interroger notre voyeurisme malsain envers les corps et les souffrances noirs.
L’ironie de l’autrice n’est pas toujours facile à distinguer car elle nécessite des références précises et une connaissance de sa voix particulière, ce qui rend son piège d’autant plus fatal. Malgré l’aspect burlesque de certains passages, il est aisé de s’engluer dans le premier degré. Cette stratégie chère à Maryse Condé installe le malaise et dérange nos perceptions morales. Il est évident, après coup, que l’écrivaine cherche à nous provoquer à travers la naïveté de son personnage et à dénoncer notre manière de prendre la fiction au sérieux, de chercher, à tout prix, un message global dans des écrits individuels mais c’est au prix de notre confort. Pour démontrer l’aspect parodique de son oeuvre, Maryse Condé évoque, lors de ses entretiens avec Françoise Pfaff, la rencontre entre Tituba et Hester Prynne, l’héroïne de The Scarlet Letter (Nathaniel Hawthorne, 1850). L’improbable échange entre ce personnage de fiction et Tituba, personnage historique, mais surtout le thème anachronique (le féminisme) et le déroulement absurde de cet entretien peuvent laisser pantoise mais révèlent la moquerie de Maryse Condé à l’égard des théories idéologiques.
Cette même ironie permet de construire un contre-discours, une vision alternative du monde. Lorsqu’Hester justifie l’innocence de Tituba à l’aide de la beauté de cette dernière, beauté qu’elle tirerait de sa couleur de peau, elle introduit un élément impensable dans le cadre de référence du monde qui met en accusation les deux femmes. En effet, pour les Puritains comme pour les Blanc(he)s de la Barbade une femme noire ne peut être belle, d’ailleurs la couleur noire est assimilée à la laideur et au malin, même pour les plus jeunes (qui sauront s’en servir pour amorcer leurs jeux tragiques). Le décalage entre les propos de cette femme blanche et l’univers dans lequel se déroulent les aventures de Tituba suscite l’étonnement puis la réflexion. Il en va de même de différents sujets tabous comme l’attirance sexuelle entre deux femmes et le désir « incestueux » pour le jeune Iphigene que Tituba a recueilli à son retour à la Barbade. Les interrogations de la candide sorcière et les affirmations naïves de la femme adultère ont pour fondation leur innocence morale mais aussi leur refus d’intégrer un monde qui ne leur convient pas et qui les rejette.
Writing Tituba was an opportunity to express my feelings about present-day America. I wanted to imply that in terms of narrow-mindedness, hypocrisy, and racism, little has changed since the days of the Puritans. Every black person living in America will tell you that racism still exists. A few success stories that are told over and over again for propaganda reasons must not hide the fact that for the majority of the blacks, life is still hell. As a foreigner and a French-speaking person, I don’t suffer directly from it. On the contrary, I am a curiosity; but I am too lucid not to see how the society works. Being in contact with many young black people as a university professor, I can see how frustrated and frightened they are by their society and how they have little hope in the future.
Maryse Condé dans un entretien publié dans l’édition américaine du roman
Mais l’ironie n’empêche pas une lecture politique du roman, au contraire, elle la sert pour mieux dénoncer la perpétuation de ce regard puritain dans les Etat-Unis du XXᵉ siècle et, sur un plan littéraire, permet à Maryse Condé, d’après Julie Brugier, de mettre en scène une performance pour le « regard et [le] lectorat blancs », comme Tituba qui a joué à la sorcière devant le tribunal formé de Puritains du Massachusetts, toutes deux les prenant au piège de leurs propres préjugés.
Malgré la violence et l’ironie mordante, on peut lire une voix qui tente, avec difficulté, d’être plus légère comme le remarque l’autrice elle-même dans « Le rire créole : entretien avec Maryse Condé », un échange avec Zineb Ali-Benali et Françoise Simasotchi-Bronès : « Il y a un narrateur dans Tituba qui essaie de se marrer, qui essaie d’être détaché de tout, mais qui n’y arrive pas, qui est rattrapé par la violence des faits et qui au fur et à mesure sombre dans le sentimentalisme ». On retrouve cette légèreté se transformant en sentimentalisme dans la relation entre Tituba et Man Yaya, son initiatrice aux sciences occultes et grand-mère idéale de contes traditionnelles ou dans les références à la culture pop lorsque Benjamin Cohen nomme Tituba « ma sorcière bien aimée » et lorsqu’elle-même choisit, après sa mort, une « descendante » nommée Samantha… TMTC.
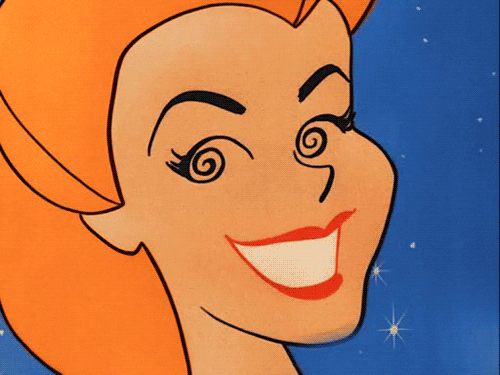
Cinq thèmes marquants du roman
- Le réalisme et la magie : les deux éléments sont complémentaires dans le monde tel que le conçoit Tituba mais totalement opposés dans celui de ses ennemis et ses détracteurs, « le monde du Livre et de la haine ». Deux figures symbolisent ces deux univers : à Salem, une figure de violence et d’intolérance, Samuel Parris, et à La Barbade, une figure maternelle détentrice de savoirs, Man Yaya. Celle-ci participe à la construction de Tituba alors que l’autre tente de contribuer à sa destruction. L’élément clé de cette frontière entre réel et magie est le passage entre le monde des morts et celui des vivants, la question de la mort et de la (re)naissance. La mort est présentée comme espace de sérénité et d’harmonie (v. la deuxième épigraphe, une citation de John Harrington « Death is a porte whereby we pass to joye ») mais elle passe aussi par le merveilleux des croyances de Tituba, un moyen de poursuivre la lutte pour la fin des souffrances et l’élévation des esclaves noirs. L’opposition entre les deux univers se traduit également dans la langue de l’écrivaine : une langue sèche, aride, froide voire brutale pour Salem et la réalité violente (cf. le séjour chez Susanna Endicott, la maîtresse de Tituba à la Barbade) qui est nuancée par une langue plus poétique, métaphorique, créolisante par ses références voire ses tournures pour la Barbade et l’univers de la magie.
- L’altérité : se construisant toujours en confrontation à un groupe dominant dont les valeurs sont la norme, il n’est pas étonnant de constater que c’est au contact des autres que Tituba va subir l’altérité et devenir « sorcière », c’est-à-dire une créature à la marge. Tituba devient sorcière par le regard des autres, en l’occurence par sa rencontre avec John Indien qui est le premier à utiliser ce substantif pour la caractériser. Elle découvre ainsi la charge du mot dans la voix de l’homme qu’elle aime : « Je m’apercevais que dans sa bouche, le mot était entaché d’opprobre » (p. 33 folio). Les interrogations qui suivent marquent l’incompréhension et la discordance entre le monde de Tituba et celui des autres, celui de la norme. À Salem, cette altérité va se renforcer car la jeune femme représente tout ce que les Puritains abhorrent : une femme donc une créature stupide sous l’empire de la chair, une Noire donc damnée, une tradipraticienne donc créature diabolique. Cependant, son altérité était déjà signifiée par le rejet de sa mère puis renforcée par le déni d’identité lorsqu’elle devint esclave à la Barbade. Le seul moment où son altérité ne se fait plus sentir en Amérique c’est lors de sa relation avec Benjamin Cohen, avec lequel se crée une sorte de solidarité des marginalisés. Pour résumer, on peut reprendre la notion d’intersectionnalité créée par Kimberlé Crenshaw pour évoquer les causes de l’altérité de Tituba : sexe, race, classe, en y ajoutant ses croyances et son insoumission chronique (contrairement à John Indien qui s’en sort (relativement) mieux en répondant au cliché blanc du noir).
- Le féminisme : en 2013, Maryse Condé déclare dans le documentaire de J. Sesquin qu’elle n’est « pas une féministe pure et dure mais [qu’elle s’] intéresse beaucoup aux problèmes des femmes, comment elles arrivent à se retrouver dans ce monde très dur, à s’y faire une place ». De plus, le discours féministe du roman n’est sans doute pas à prendre au sérieux puisqu’il est anachronique comme le rappelle Ching Selao et de surcroît ironique car se construit dans un rapport de domination entre la femme blanche et la femme noire lorsque Hester réduit Tituba au silence alors que celle-ci l’interroge sur son féminisme. La « réticence [de Maryse Condé] porte moins […] sur les engagements du féminisme, que sur le terme « féministe » lui-même et son présupposé d’universalité – lequel ne permettrait pas de rendre compte de son expérience de romancière antillaise » ajoute Julie Brugier. C’est donc une sorte de rejet de ce qu’elle appelle « le féminisme à l’occidentale » (in Entretiens avec Françoise Pfaff citée par J. Brugier). La chercheuse nous invite à regarder du côté du womanism d’Alice Walker (autrice de La Couleur pourpre), à travers de nombreux éléments du roman de Maryse Condé tels que la connaissance du monde naturel transmise de façon orale et matrilinéaire (liens avec la métaphore du jardin d’Alice Walker qui veut illustrer l’esprit créatif des femmes noires occulté par des siècles d’oppression) ou la présence du surnaturel (sorcellerie et vaudou) souvent associé à un pouvoir féminin afro-américain. Pour Angela Davis, la sorcellerie de Tituba est perçue comme une forme de résistance authentique, antillaise et féminines voire womanist.
- L’identité : en tant que narratrice, la voix de Tituba est importante, mais en tant que personnage sa voix est marginalisée. Pourtant (ou parce que) elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense, comme nous l’avons vu plus haut, et revendique sa liberté d’action même lorsque ses actions sont négatives ou douloureuses (devenir esclave par amour ou avorter pour ne pas imposer une vie de souffrance à un « petit innocent »). L’identité de Tituba se construit donc par le rejet des éléments de soumission à l’ordre établi comme le rappelle Josée Tamiozzo. Dans le même élan, elle nous démontre comment l’identité de Tituba se construit et se modifie au fil de ses rencontres : elle apprend son corps et la sensualité grâce à John Indien, elle découvre sa capacité de haine et sa volonté de vengeance face aux Blancs, l’hystérie collective de Salem bouscule ses valeurs morales. Son regard extérieur critique et observe les sociétés qu’elle rencontre mais dans lesquelles elle reste une paria. Le choix du titre du roman illustre en définitif assez bien le paradoxe de Tituba : singulière par choix et par assertion « Moi, Tituba » et Autre par la curiosité malsaine du groupe dominant qui la caractérise en tant que « sorcière Noire de Salem ».
- L’amour : malgré ses souffrances, Tituba est toujours mue par un amour et une compassion pour les autres. Ces sentiments qui sont souvent confondus avec la naïveté par des personnages plus cyniques (ou réalistes) qu’elle tels que John, Christopher ou même Iphigene couvrent sa vie de malheurs. Dans un numéro d’Apostrophes, alors qu’elle présente son livre Segou, Maryse Condé répond à Bernard Pivot, qui remarque la violence présente dans l’oeuvre, « il y a le drame de l’histoire mais il m’a semblé beaucoup d’amour au fond ». On rencontre la même situation dans Tituba : un contexte historique qui rend incontournable l’intrusion du drame dans la vie des personnages mais un amour sincère et une empathie profonde pour les faibles et pour les autres dirigent le personnage principal. On peut ajouter à cela, pour Tituba, une volonté farouche d’être aimée et respectée qui conduit sans cesse à la déception jusqu’à la libération que représente la mort. C’est parce qu’elle a trop voulu donné aux autres que Tituba se retrouve prise au piège de Salem, comme la civilisation bambara de Ségou, détruite car trahie par sa générosité…
5 conseils ou vœux de lecture
- Segou, le best-seller de Maryse Condé.
- La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne puisque Moi, Tituba sorcière… parodie ce roman
- Sorcières, la puissance invaincue des femmes, le dernier essai de Mona Chollet pour une introduction (parfois trop superficielles) au regain de cette figure féminine
- Un biopic sur la vie de Maryse Condé, comme le propose Françoise Pfaff, autrice d’entretiens avec l’écrivaine.
- Les écrits d’Alice Walker dont le classique The Color Purple
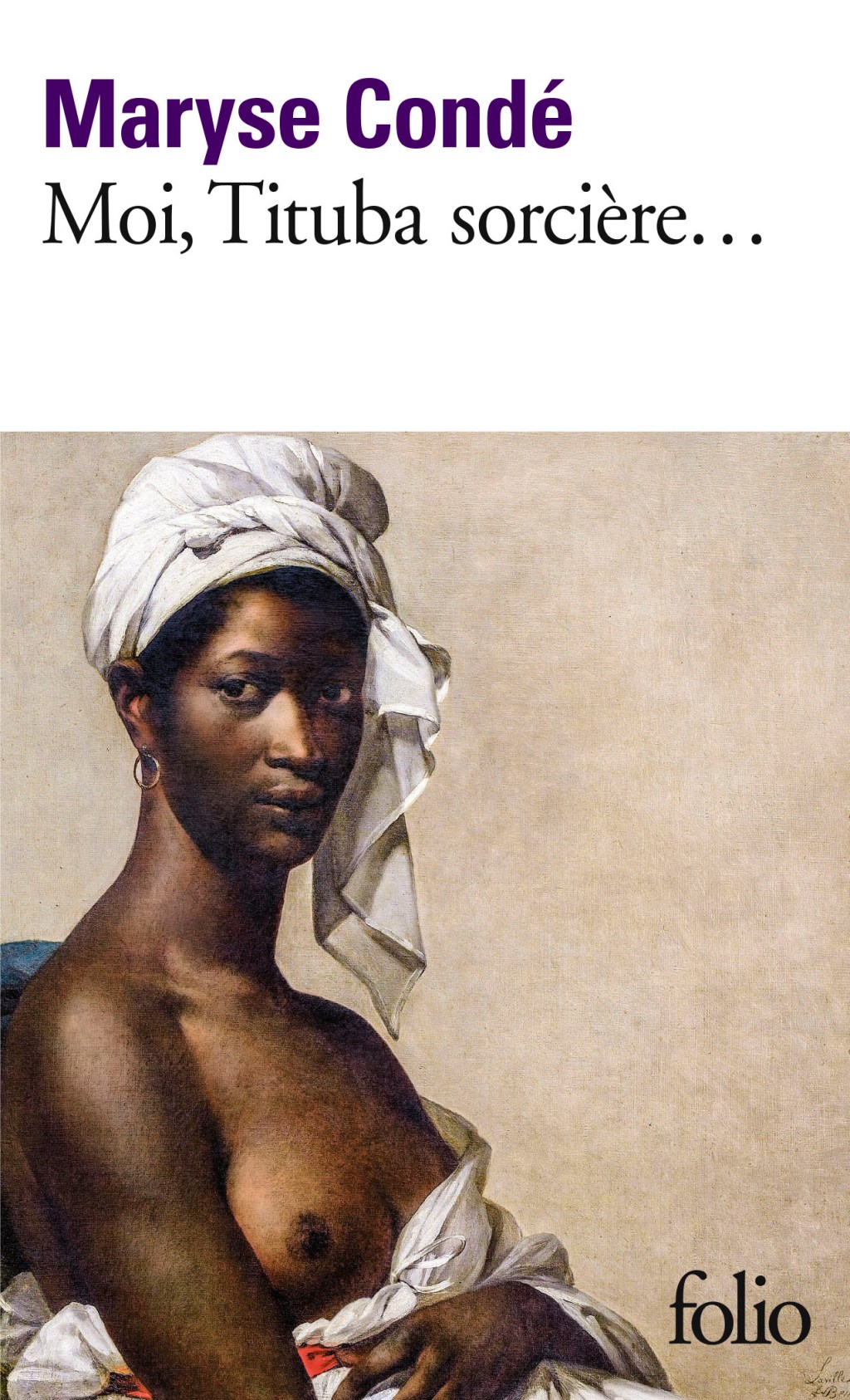
Répondre à tamtam.bou Annuler la réponse.